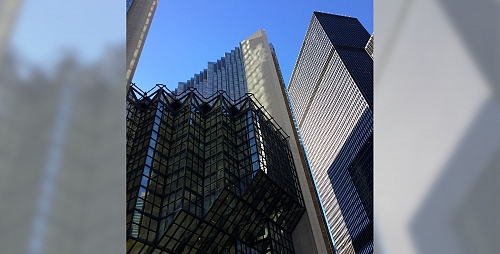 Crédit : « L’ange éploré, tout en haut », Toronto. © Luce DES AULNIERS (2018).
Crédit : « L’ange éploré, tout en haut », Toronto. © Luce DES AULNIERS (2018).
Avec les monuments aux morts, l’espèce humaine a peu à peu cristallisé sa pensée sur la finitude et son aspiration à une forme de continuité alliant matière et esprit. Or, cette aspiration s’est débordée elle-même dans les idéologies de l’infinité : le génie architectural serait-il au service de la pensée ? Et/ou… de l’impensé de la croissance illimitée ?
Récit 4
|
« Luce, pourquoi y a des anges [en statues] ici ? » […]
|
Accueillir les défunts s’établit en mode souterrain. « Non, Lina, ils n’ont plus froid, ils ne ressentent plus rien, c’est ça, être mort… La terre, c’est comme leur doudou, mais ils ne le savent pas, ils ne le sentent pas… Mais toi, si tu penses un peu aux “mourrus”, ça te fait chaud au cœur. Si tu contes à ton papa comment ta mamie te prenait dans ses bras, ça réchauffe son cœur qui a de la peine. Si tu vas voir l’ange sur la tombe de ta mamie, tu as chaud au cœur à l’idée que ta mamie est moins toute seule, même enterrée à côté de papi… »1
Ainsi, oui, reconnaître et évoquer l’humanité, fût-elle biographiquement éphémère, s’élabore en mode surterrain. De fait, pas de société des morts sans monuments. (Les anges attendront un autre récit…) Et pas de souci rasséréné des morts sans ces matériaux fiables. Et ces ornements…
Néanmoins, les morts n’ont pas toujours bénéficié de monuments, ni de monuments individualisés, et encore moins de monuments identifiés à une personne.
Mais autant qu’on le sache, on a éprouvé très tôt le besoin de les localiser. Si de simples fosses recueillaient les corps des ancêtres — entre 200 000 et 10 000 avant J.C — on pouvait savoir qu’il y avait un « mort-là » ou un « ci-gît » par la terre remuée et replacée, formant un monticule ou une tombe : une excroissance, qui, dans les langues indo-européennes, traduit un gonflement. L’herbe y poussant, on a voulu par suite lui donner une forme symétrique et esthétique : les tumulus de toutes dimensions se retrouvent ainsi et encore de nos jours sur tous les continents. Les vivants ont ainsi cherché à pérenniser le renflement observé mais tout autant fragile aux vents, aux pluies… et au tassement de ce qui se trouve également dessous2.
Parallèlement à ces monticules et venant parfois les coiffer, s’était très tôt imposé l’amas de roches, plus ou moins choisies. On ne peut l’expliquer uniquement par la protection à l’endroit des bêtes fouisseuses ou ultérieurement, envers d’autres fouineurs impénitents, ces pilleurs à deux pattes… Mais on entend le désir de signaler dans la durée, en utilisant le matériau dur. J’y reviendrai.
Par exemple, dans la Grèce antique, vers 10 siècles avant notre ère, il semble que l’on ait enterré les morts sur les bords des chemins caillouteux. On y apposait une borne : une petite pierre oblongue, bien fixée au sol. Or, de borne en borne, s’est développé peu à peu un système de repérage pour les voyageurs. C’est ainsi qu’est apparue une formidable et inusitée solidarité : le code signalétique de l’existence même des morts traduisait également la volonté d’orientation et de conduite des vivants. La trouvaille des bornes associées aux morts s’est ensuite distribuée mathématiquement comme un marqueur des distances à parcourir, comme un jalonnage fiable afin de ne pas perdre son trajet de vue.
Bilan sur cette corrélation : le Code de la route comme code de coexistence de la vie et de la mort? Si c’était le cas, qu’en déduire ? Que la fréquentation du lieu des morts soit vécue non pas exclusivement comme une obligation collective, comme un souvenir éventuellement nostalgique, mais davantage comme un pousse-à-lier : se lier les uns et les autres, ces vivants sur leur chemin existentiel, et se lier au fait que connaître, c’est aussi relier du contemporain avec de l’histoire.
Nos jalons sont historiques, on le sait quasi d’instinct. Et justement, les sources archéologiques convergent : un monument a d’abord désigné un tombeau ou ce qui se pose au-dessus de la tombe. Mais l’étymologie ne nous perd pas non plus. En effet, « monument » provient de monumentum, et lui-même, de monere : désigner, faire penser, se souvenir. « Monument », « monstre »3 et « mental », ont une racine commune : men-, ou penser. Penser… ou lier.
Mais comment montrer, comment faire penser ? Si l’on revient aux domiciles des morts, signaler de-ci et de-là leurs traces physiques ne suffit pas. Pourquoi ? Dans l’histoire humaine, la pensée même d’une quelconque existence des morts s’avérera indissociable de la pensée que les humains développent d’eux-mêmes et des mondes. Reliés.
Car voilà que dès 10 000 ans avant notre ère, le nomadisme laissait peu à peu place à la sédentarisation. Dans la foulée des organisations sociales favorisant l’agriculture et l’élevage (par exemple, le Néolithique — de -5 000 ans av. J.-C. — en Europe), les tâches se spécialisaient, en vue d’une coordination renforcée des efforts collectifs. Le tout sous la coupole mythologique où nature et surnature s’articulaient tranquillement d’autant.
Le symbolisme magique initial (chez Homo Sapiens, aimer croire au mystère) se doublait alors de symbolisme religieux (aimer croire en des puissances suprahumaines) : ainsi la mythologie préhistorique du passage des morts dans une outre-vie si peu éloignée de celle des vivants se renforçait de la conviction d’un monde des morts avec aussi ses règles propres et ses interlocutions symboliques (désignée au récit no 3 comme « société »). Notre identité défensive et toujours bienvenue devant la perte se doublait alors d’une identité proactive et prévisionnelle : non seulement les défunts existeraient dans un monde parallèle auquel l’accès est adouci par nos précautions (offrandes élémentaires, enduits des visages et des crânes, ces germes du rite), mais s’appuyer sur eux et leur destinée supputée influencerait la survie des groupes humains.
Les défunts sont ainsi mis à contribution comme épine dorsale de ce nouveau rapport au temps. Le culte original des morts, basique et dispersé, s’est ainsi structuré peu à peu en culte des ancêtres, ceux de qui on peut se référer et transmettre un tant soit peu. Déjà, on commençait à regrouper ces morts ancestralisés, il y a -10 000 ans. Ces regroupements sont devenus par suite de véritables nécropoles. Et qui dit regroupement dit hiérarchie… (Je ne m’attarderai pas ici sur le caractère social de cette élaboration, mais sur le monument-monumentum.)
Or, la petite Lina le vérifiait à sa manière et à une époque si autre : s’il y a néanmoins un monument sur lequel s’appuyer, au propre et au figuré, c’est bien le dolmen. On retrouve la racine (-men) qui renvoie au phénomène de penser. Et si on se fie à « méga » de mégalithe (-lithe : pierre), cela donne « penser grand » ? Et ce, autant en Asie qu’en Europe, qu’en Amérique.
Parallèlement à l’amoncellement universel de galets et de cailloux de taille modeste, se dresse un monolithe, pierre tout d’un bloc, qui caractérise ces fameux dolmens. Le monolithe-dolmen ne fait pas que délimiter l’espace des tombes collectives, mais sert d’assise par entrecroisement (herculéen…) à des structures qui abritent des chambres funéraires4. Et, en bordure des villages, c’est en ces lieux que s’institue le culte de la Déesse Terre, à qui les cycles végétaux et du vivant — dont les morts — sont dédiés. On pouvait y déposer des offrandes, si on évoque la racine bretonne : dol signifiant ici « table », et men, « dalle ». Fécondité jamais assurée et solidité éternelle se trouvaient réunies dans cette forme de matrice créatrice du symbolisme, et par la médiation des morts.
Quant à eux, les menhirs seraient une variation bretonne du dolmen, qui reprend les caractéristiques du premier, mais surtout cette fois dans une verticale entre 1 et 12 m (hir signifiant « long »). Comme les dolmens, ils peuvent être enlignés ou disposés en demi-cercles ou en cercles (les cromlechs : « lieu des cercles ») ; ils peuvent à la fois être gravés de figures anthropomorphiques signalant le désir d’immortalité de l’âme, voire le siège5 de son incorruptibilité, et soutenir une activité cultuelle et « scientifique » astronomique.
Arrêtons-nous sur ces données. Et croisons les postures anthropomorphiques mises en évidence par ces sépultures et leur signalement, encore une fois dans l’histoire longue des sentiments à l’égard du destin :
« C’est ainsi qu’à la position couchée associée au repos et au repos éternel, à la limite humaine plus ou moins consentie, [Homo sapiens] a[urait] délibérément opposé et apposé la stature debout. Après les amas de roches, une pierre haute marquait ainsi verticalement la parcelle de terre où un humain gisait, horizontalement. Du croisement symbolique et physique de ces deux plans est apparu notre premier code signalétique stable, notre premier moyen de transmission et de partage, bien avant l’écriture, pavant la voie à ce constat inépuisable : la mort ou plus particulièrement la présence du mort fait communiquer et échanger les vivants entre eux. Au temps présent de la mort, la pierre témoignait d’une nique au destin, et de ce fait, exprimait l’exigence de faire quelque chose plutôt que de ne rien faire. Le rituel s’esquissait. » (Luce DES AULNIERS, 20016)
Cette détermination d’empreinte a marqué le long processus de civilisation : devant le Rien potentiel de la mort, vertigineux, on a voulu ériger en solide. Pulsion phallocrate, a-t-on-dit. Une telle interprétation se vaut. Mais la polysémie nous entraîne aussi vers ceci : dans le monument dressé et fabriqué dans le matériau dur s’exprime l’élan de perdurer par-delà la mort, élan proprement spirituel. Le temps humain est constaté, le temps intemporel est convoqué. La pensée déjoue symboliquement la mort.
Avançons encore. S’instaure dans notre esprit cette mise en lien : d’une part nous acquérons une connaissance sensorielle de la matérialité — ici une matérialité élevante — et d’autre part la vie de l’esprit nous permet d’assentir à la conscience douloureuse de la mort. Il ne s’agit pas d’acceptation de la mort au plan affectif, mais de la reconnaissance de son phénomène comme universel, simplement parce qu’un monument symbolise le destin. Cette connaissance reliée nous fait dépasser l’impact atterrant de la mort. Tant et si bien que toutes nos créations sont tributaires de cette imbrication entre matérialité tangible et élan de l’esprit.
Il se trouve que l’impulsion de hauteur et d’envol ne nous a pas donné que les anges en sollicitude sur les « mourrus ». Les flèches des cathédrales, ce de quoi elles résultent si fabuleusement, et tant de temples, et puis les statues des héros, voire les « gratte-ciel » témoignent aussi à la base du désir de consolation. Et d’émulation vers une humanité affinée.
Jusqu’à ce que nous oubliions en partie ce de quoi nous consoler, si profond et si vivifiant. Ce de quoi et en quoi les peuples peuvent s’affiner.
Jusqu’à nous nous aveuglions, repus de l’injonction au « toujours plus », quel qu’en soit le prix.
Peut-être que les anges pleurent sur cela, aussi, et désormais ?
LUCE DES AULNIERS
Professeure-chercheure
Notes
- Fragment d’une conversation avec Lina, 4 ans, lors d’une visite dans un cimetière rural.
- En témoigne avec éloquence la grande tombe de New Grange, Irlande, vers 3400 ans av. J.-C., édifiée quasi 1000 ans avant les pyramides de Gizeh. Cet ovale de plus de 90 m, d’une hauteur de 15 m, cerclé en assise d’une centaine de monolithes, abrite plusieurs chambres intérieures et est notamment aussi reconnu pour son ouverture de part en part qui laisse passer la lumière lors de l’équinoxe d’hiver. Cet indice majeur de sacralité se renforce par la disposition en cercle externe de menhirs. (Voir dans la suite de ce récit la signification de ces éléments architecturaux.)
- Mais la monstruosité, justement parce qu’impensée, nous donne… à penser. Voir le très beau livre de VACQUIN, Monette (2016). Frankenstein aujourd’hui. Égarements de la science moderne, Paris, Bélin, 326 p.
- Ces tombes souterraines à chambres multiples forment un hypogée, dont un exemple notoire se trouve à Hal Saflieni, dans les îles de Malte, -5 000 ans : 33 chambres, sur 500 m2, asile de quelque 7 000 corps. Sources : SILIOTTI, Alberto (dir.) (2000). Demeures d’éternité, (ill.), Paris, Gallimard, 304 p. Voir aussi HALLAM, E. et J. L. HOCKEY (2001). Death, Memory, and Material Culture, Coll. « Materializing culture », Oxford, Angleterre, Berg, 264 p. ; GNOLI, G. et J.-P. VERNANT [dir.] (1982). La mort, les morts dans les sociétés anciennes, Paris, Édition de la Maison des Sciences de l’Homme, 506 p.
- Le siège d’un des principes spirituels contribuant à la personne humaine se retrouve aussi bien ailleurs, notamment pour les cultures animistes : la tombe y sert de refuge ponctuel, dans le foisonnement de la vie végétale, minérale, aqueuse, à laquelle appartient l’humanité.
- DES AULNIERS, L. (2001). « Le monument funéraire est-il un support indispensable à la commémoration des morts et à la résolution [sic] du deuil ? », Colloque L’avenir des cimetières, Écomusée de l’Au-delà, UQAM et Musée de la Civilisation, Québec, octobre et novembre 2000, Actes du colloque, 2001, pp. 128-142.
Télécharger la version PDF de cet article
Fragment d’une conversation avec Lina, 4 ans, lors d’une visite dans un cimetière rural.
En témoigne avec éloquence la grande tombe de New Grange, Irlande, vers 3400 ans av. J.-C., édifiée quasi 1000 ans avant les pyramides de Gizeh. Cet ovale de plus de 90 m, d’une hauteur de 15 m, cerclé en assise d’une centaine de monolithes, abrite plusieurs chambres intérieures et est notamment aussi reconnu pour son ouverture de part en part qui laisse passer la lumière lors de l’équinoxe d’hiver. Cet indice majeur de sacralité se renforce par la disposition en cercle externe de menhirs. (Voir dans la suite de ce récit la signification de ces éléments architecturaux.)
Mais la monstruosité, justement parce qu’impensée, nous donne… à penser. Voir le très beau livre de VACQUIN, Monette (2016). Frankenstein aujourd’hui. Égarements de la science moderne, Paris, Bélin, 326 p.
Ces tombes souterraines à chambres multiples forment un hypogée, dont un exemple notoire se trouve à Hal Saflieni, dans les îles de Malte, -5 000 ans : 33 chambres, sur 500 m2, asile de quelque 7 000 corps. Sources : SILIOTTI, Alberto (dir.) (2000). Demeures d’éternité, (ill.), Paris, Gallimard, 304 p. Voir aussi HALLAM, E. et J. L. HOCKEY (2001). Death, Memory, and Material Culture, Coll. « Materializing culture », Oxford, Angleterre, Berg, 264 p. ; GNOLI, G. et J.-P. VERNANT [dir.] (1982). La mort, les morts dans les sociétés anciennes, Paris, Édition de la Maison des Sciences de l’Homme, 506 p.
Le siège d’un des principes spirituels contribuant à la personne humaine se retrouve aussi bien ailleurs, notamment pour les cultures animistes : la tombe y sert de refuge ponctuel, dans le foisonnement de la vie végétale, minérale, aqueuse, à laquelle appartient l’humanité.
DES AULNIERS, L. (2001). « Le monument funéraire est-il un support indispensable à la commémoration des morts et à la résolution [sic] du deuil ? », Colloque L’avenir des cimetières, Écomusée de l’Au-delà, UQAM et Musée de la Civilisation, Québec, octobre et novembre 2000, Actes du colloque, 2001, pp. 128-142.
